Catégories : Femmes fessées
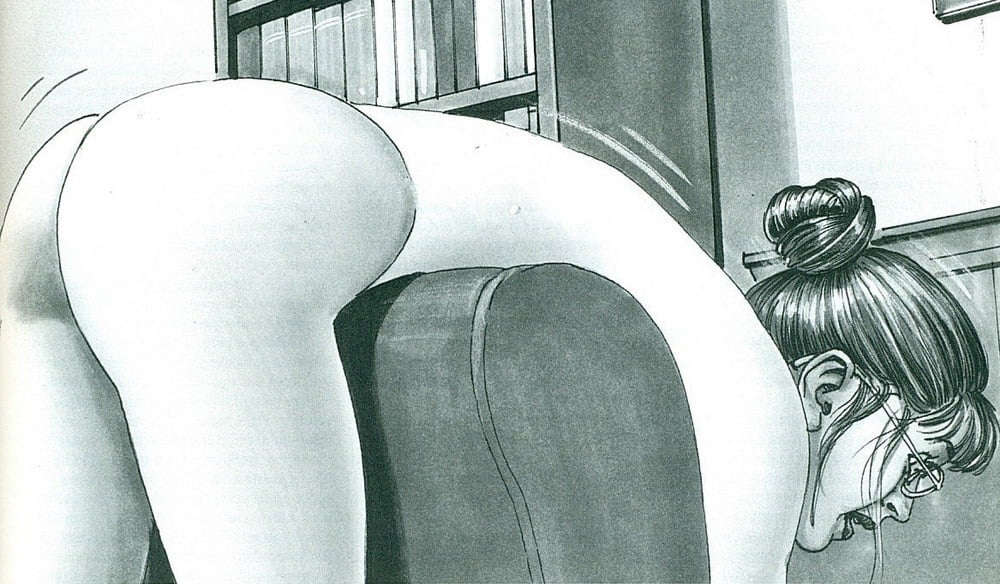 il y a 4 ans
il y a 4 ans
Par Sophie (avec le concours d’Edmée)
On ne change pas ses passions. Mais elles savent vous changer la vie. Elles sont sans âge, même si elles prennent vos années. Les oublier ? Elles ne vous oublient pas ! Aussi peut-on être femme à trente ans sans jamais devoir renoncer à la jeune fille que l’on fut aux heures tendres de l’innocence, si frémissantes à l’appel de l’inconnu.
Toute jeune, j’aimais la nature, l’herbe folle et les petits oiseaux… Mais dirai-je assez combien je détestais les bouleaux ? A mes anciennes amours, je reste fidèle. Aujourd’hui encore, parlez-moi de tous les arbres de la terre, sauf des bouleaux. N’aurais-je pour leur silhouette gracile et leurs fins rameaux qu’une injuste aversion ? A leur vue, mon cœur tressaille, mes tempes battent, et mon esprit se fige dans de troublants souvenirs.
En chemin, leurs silhouettes argentées m’interpellent et leurs murmures frissonnent de leurs échos dans tout mon être. Tout en eux m’exalte comme seul sait le faire le plus séduisant mais le plus impudent des charmeurs de rencontre.
Qu’ai-je à leur reprocher ? De quelle déraison s’alimentent ces émotions alors que s’offrent docilement aux moindres souffles qui les brassent les grappes légères de leur feuillage tremblant ?
Quand la brise les agite, ma peau se couvre aussitôt de frissons. J’en veux sans doute à certain usage auquel on les voue. Regardez-les de plus près. Voyez leurs ramures se balancer dans le vent. Innocents faisceaux de brindilles ? Ou bouquets de méchantes griffes plus piquantes que des orties ? Tantôt gracieux ornement des parcs, tantôt… verges sifflantes de cruelle justice. Ici, charme des printemps. Là, sourde détresse, cris et larmes accompagnant sifflement et claquements entre des murs clos.
Les entendez-vous qui pourfendent l’air, arrachant les plaintes et les prières de jeunes filles en pleurs ?
En cadence, les voici qui empourprent de sombres parures les juvéniles rondeurs offertes toutes nues à leurs coups. Pitoyables carnations féminines ! Douces chairs de servantes négligentes ou d’écolières désobéissantes ! Teint de lait ou teint doré de splendides nudités promises au plus vif incarnat… Et combien d’âmes marquées à vie autant par la chair que l’esprit ? Comme je vous plains mes camarades, vous qui, comme moi, avez tant de fois goûté aux morsures des fessées aux verges de bouleau…
Je me prends à rêver de ces temps de fête, de ces lointaines chasses gardées de l’a d o l es c e n c e où l’imagination accorde aux plaisirs des sens la perfection sans partage d’un monde de liberté. Il suffisait de rêver de caresses pour qu’aussitôt le corps s’enchante de volupté ; d’espérer un baiser, que des lèvres gourmandes pressent aussitôt les vôtres ; de tendre son corps, que des mains vous en arrachent des soupirs sous la tiédeur des draps.
Le rêve se donnait en silence le spectacle de ses illusions. Immersion des sens dans un songe éveillé, le plaisir entre chien et loup errait à la lisière du sommeil et de la réalité. Plénitude d’une création à satiété. Plus d’abîme entre l’idéal et son accomplissement. Le goût du désir et la soif du plaisir fusionnaient leur émotion dans la complicité d’un impossible accord, comme le jumeau avec son double. Rien à quémander. Surtout se taire. Tout arrive enfin !
On n’oublie pas sa jeunesse. On ne saurait oublier La Pension des Bouleaux ni son grand parc tendu de verdure, ni la vaste demeure pleine des rires et des pleurs d’autrefois. On ne saurait non plus oublier leur directrice, la redoutable fascinante Maîtresse Celia.
Chère Maîtresse !… Vous souvenez-vous de vos écolières ? Rebelles à leur arrivée, vous les vouliez dociles, à vos pieds, définitivement soumises à leur départ. Belles, elles l’étaient plus encore, demi-nues, implorantes entre vos mains cruelles.
Quinze ans déjà ! L’une d’entre elles se souvient comme si c’était hier d’une brochette de demoiselles qui, dans le désordre des vêtements troussés et des pantalons rabattus sur leurs croupes dénudées, apprenaient des mains de leurs préceptrices de cuisantes leçons d’obéissance…
Cependant, aucune ne pouvait égaler votre brûlante passion de fouetteuse …
Chère Maîtresse Célia, aucune de vos pensionnaires ne pourrait oublier l’étrange et brusque bouleversement de leurs sens quand elles devaient se livrer à vous pleines de repentir pour recevoir l’un de vos mémorables châtiments corporels.
Un certain soir, vous m’avez révélée à ma sensualité. Étais-je prête ? … Combien de fois ai-je reçu les verges ou le fouet ? De ces années, la mémoire du temps entretient la nostalgie. Aujourd’hui, permettez à votre ancienne pensionnaire d’en témoigner.
Au chapitre des leçons d’éducation à la Pension des Bouleaux, l’apprentissage de règles et devoirs de discipline formaient l’ordinaire des jours des pensionnaires. Il fallait les connaître sur le bout des doigts et veiller à les appliquer jour et nuit. Tenue et maintien incombant à toute demoiselle de bonne famille, politesse et respect révérencieux à l’égard des adultes, obéissance immédiate, aucun relâchement possible, nos préceptrices y veillaient.
En effet, elles étaient aussi attentives à la tenue de vêtements qu’à leur propreté. Notre uniforme était chic, notre linge intime résolument immaculé. Sachez que cette attention devait moins à la frivolité de nos préceptrices qu’à leur conception rigoureuse de la discipline dans l’éducation des demoiselles. Nos toilettes et nos corps étaient soumis à des contrôles aléatoires. Gare à celle qui présentait un corsage chiffonné ou des ongles mal taillés ! De ce point de vue, un visiteur de passage aurait eu un rapide aperçu de ce que pouvait coûter un simple oubli, une étourderie.
Cette exigence, rigide comme une règle de vie, ne souffrait aucune entorse. Ce qui ailleurs, aurait pu passer pour un simple agrément était ici un véritable sujet de chagrin. Ainsi, il n’était pas de jour où chacune de nous ne mît un point d’honneur à se faire belle, surtout les vendredis. Le vendredi ? Un jour pas comme les autres à la Pension des Bouleaux ! Les anciennes le savaient d’expérience et les nouvelles… mon Dieu ! … l’apprenaient vite à leurs dépens. Le vendredi était en effet le grand jour de pénitence.
Oh ! La semaine suffisait bien à sa peine. Nos chères préceptrices avaient toutes à cœur de châtier sur-le-champ les fautes les plus vénielles. En classe, en récréation, au dortoir, au réfectoire, en promenade, la fessée régnait en maîtresse souveraine. Pour les fautes les plus graves telles que la rébellion, les désobéissances répétées, l’insolence, je puis dire qu’à toute heure du jour et de la nuit, les fautives trouvaient dans l’instant des mains serviables prêtes à les corriger. Mais jamais comme le vendredi… Jamais comme au cours du terrible tête-à-tête avec la redoutable Maîtresse Celia, notre directrice bien aimée.
A cette occasion, elle seule officiait. Point d’échappatoire, surtout pour les plus effrontées. Les coupables lui avouaient les fautes de la semaine. La fessée, le martinet ou le fouet en soldait le compte sur-le-champ. Le rite était immuable. Vous languissiez seul ou en groupe derrière la porte de son bureau, transie d’appréhension. Au signal, vous entriez, le rouge au front, la gorge sèche, les oreilles bourdonnantes.
Vous aviez beau implorer votre pardon à genoux, faire mille belles promesses. Vous ressortiez en larmes, votre postérieur brûlant d’un cuisant châtiment corporel ainsi que le prévoyait la méthode de discipline de la pension.
En vérité, Maîtresse Célia était une étrange personne. De toutes nos préceptrices, c’était de loin la plus belle et la plus élégante. D’une beauté racée et d’une prestance raffinée. À trente-cinq ans, elle incarnait un idéal de féminité et de séduction et l’autorité qui émanait naturellement d’elle f o r ç a i t le respect. Face à elle, j’étais éperdue de crainte mais aussi d’admiration, une dévotion proche de la soumission. Je n’étais pas la seule ! Toutes les pensionnaires, même les plus jeunes, éprouvaient la même fascination pour cette créature altière et rêvaient de lui ressembler.
Dans mon souvenir, je vois toujours sa tête qu’encadrait une longue chevelure brune dont les mèches bouillonnaient en liberté ou s’assagissaient sous un foulard de soie. Le visage s’allongeait dans un ovale parfait. Les lèvres délicates dessinaient une bouche charnue. L’arc épais des sourcils soulignait l’éclat des yeux. Sous la frange des cils, ils jetaient d’éblouissants reflets verts poudrés d’or qui vous saisissaient comme l’oiseau pris au piège de sa curiosité.
Mieux que des mots, son regard savait vous dire à quoi vous deviez vous en tenir. Glacé de hautaine indifférence ou cillant de colère, fondant de douceur ou s’ombrageant de pitié, au gré des circonstances, il nous donnait à comprendre si l’on avait mérité ou démérité, honneur et récompense ou sévère fessée déculottée.
A sa taille étranglée, à sa croupe ronde qui saillait sous la cambrure des reins, à ses seins hauts et fermes, on devinait la jeunesse d’un corps musclé aux formes déliées. Tout le chic de sa mince silhouette s’exaltait dans la souplesse de la démarche. Elle allait d’un pas aérien, façonnant l’espace à la mesure de son corps tout de beauté.
Les traits du visage tout en nuances, exprimaient en une sorte de langage silencieux, les impressions du moment. C’étaient mille signes à peine perceptibles, plus expressifs qu’un long discours. La bouche s’arrondissait-elle d’une moue ? On doutait de vous. Froncement des sourcils ? Votre attitude avait déplu. Les yeux s’éclairaient-ils d’un sourire ? On avait de l’indulgence. Brillaient-ils d’une vibrante lueur ? C’était la disgrâce. Animées, les fossettes ? On était contente de vous. Lointain, le regard ? On vous ignorait. Et gare à celles qui tardaient à en saisir les changements !
Il n’était jusqu’au timbre de sa voix auquel notre sort était suspendu. Une mélodie calme aux inflexions profondes et caressantes qui nous faisaient vibrer sous son charme. Qu’elle nous complimente ou nous sermonne, jamais un ton plus haut que l’autre. Sur le même registre uni des graves, Maîtresse Célia pouvait aussi bien nous bercer de douceur que nous plier à ses volontés d’un ton sec claquant comme un ordre.
Pour ses tenues, Maîtresse Célia affectionnait le vert et le noir. Ses robes, ses jupes et ses corsages étaient coupés dans de riches étoffes ou dans les peaux les plus tendres. Les soies chatoyantes des chemisiers ou des jupes s’évasaient sur l’émouvante générosité des chairs : seins altiers de la maturité charnue ou galbe d’une croupe que le moindre pas agitait d’un furtif mouvement de balancier.
Sa garde-robe disposait d’un autre vêtement : un short très court en satin de soie noire qu’elle revêtait spécialement avec un corsage blanc fortement échancré sur sa poitrine lors des séances de pénitences et de châtiments corporels du vendredi. Nous en avions une vision plus affolante ce jour-là, Maîtresse Célia révélant pleinement à nos sens en émoi la plénitude de sa sensualité.
Pour la circonstance, elle paraissait à peine vêtue de ce troublant uniforme qui donnait une aisance et une précision parfaite à ses mouvements pour nous appliquer le châtiment. Le buste étroitement lacé dans un corsage de soie laissait jaillir hors de l’étoffe la naissance des seins. Le short de satin enserrait ses hanches et ses cuisses à la manière d’un fourreau qui, en contours d’ombre et de lumière, épousait le galbe de sa croupe haut perchée comme une seconde peau qui ne dérobait rien de l’évidente nudité.
Ses cuisses et ses mollets restaient nus, la peau juste teintée d’un léger hâle. Les pieds étaient chaussés d’escarpins vernis à talons bas. Parfois de longs gants en chevreau noir gainaient ses bras jusqu’à la pliure des coudes. Une résille emprisonnait sa chevelure et un ruban de velours habillait la nudité de son long cou, achevant ainsi de souligner pour la circonstance une allure de sensuelle sévérité dont aucune de nous ne pouvait espérer la moindre compassion.
Combien d’entre nous eurent jamais le privilège d’effleurer ces joyaux de pure beauté, d’y enfouir leur visage ? Secret bien gardé !
Au reste, le risque de représailles dressait une barrière de silence entre confidences et curiosité. Cependant, en certaines nuits très agitées, parmi le chuchotis des rêves égarés, j’ai pu me rendre compte que je n’étais pas la seule à être admise dans l’intimité de Maîtresse Célia.
Auprès d’elle, tout contre elle, d’autres filles que moi avaient pu s’initier au goût sauvage des désirs les plus rares et apprendre à y succomber.
Toutes nos préceptrices adhéraient au même principe : toute fessée se donne nécessairement à derrière nu. Quels que soient le lieu ou l’heure, la jupe de la punie était troussée, sa petite culotte découlissée et rabattue à ses chevilles. Le soir au dortoir, il suffisait de relever notre chemise de nuit aux épaules pour présenter nos fesses nues.
Il arrivait aussi que l’on soit mise toute nue pour être fessée puis d’être mise à genoux les fesses brûlantes au milieu de la travée centrale entre les lits pour une pénitence qui pouvait durer une éternité. Seule la méthode d’application différait de l’une à l’autre au gré des habitudes ou des préférences de chacune d’elles. Question d’humeurs ou d’état d’esprit !
Nous connaissions aussi l’impatience agacée durant leurs interminables sermons qui savaient si bien se jouer de l’amour-propre sans autre démonstration que quelques claques sous une robe à demi relevée. Mais notre grande frayeur, c’étaient les improvisations. Sans avertissement, la correction tombait sur place, séance tenante.
Debout, la punie était sommée de relever sa robe ou sa jupe et, en quelques mordantes cinglées de lanières de cuir, ses cuisses et ses mollets se couvraient de zébrures écarlates.
Trois d’entre elles jouissaient d’une réputation d’extrême sévérité. Miss Lucy, notre professeur d’anglais avait une inclination certaine pour les châtiments en public. À ses yeux, rien de plus m o r t ifiant qu’une séance de déculottage devant les condisciples.
Ses mises à nu méthodiques de la croupe à punir égalaient largement la correction elle-même. Pour abaisser notre superbe, son imagination raffinée déployait des trésors d’invention. Jamais de jupes assez vite retroussées ni de culottes trop vite baissées. La punie devait endurer les lenteurs voulues des mains qui, lentement, par petites reptations, découvraient une hanche, puis l’autre, et révélaient l’amorce du sillon fessier.
Et de recommencer tant et plus le déculottage comme on épluche une banane, la fine étoffe dénudant sous nos yeux la croupe que la transparence du léger vêtement nous avait laissé deviner. Puis on voyait cette belle croupe saillir, fermement tenue et coincée sous le bras de la préceptrice.
Et là, dans un silence à la fois atterré et intéressé, le souffle suspendu, on n’entendait plus que le crépitement attendu de la main sévère sur les chairs rebondies de la jeune fille à bout de nerf, larmoyante de douleur et de honte et ce jusqu’à ce que la préceptrice lui leste le derrière d’une vigoureuse et impitoyable fessée.
Une autre, Mademoiselle Christine, notre surveillante, confiante dans la valeur exemplaire des leçons du martinet, ne se déplaçait jamais sans lui. Prompte à en faire usage à nos moindres peccadilles, elle l’accrochait en évidence à sa ceinture, inquiétant symbole de son autorité.
Luisantes de menaces, ses lanières de cuir se balançaient mollement au bout du manche à chaque mouvement comme si elles se préparaient à fouetter l’une de nous. En récréation, en promenade, au dortoir, tous les regards se braquaient sur lui. Désormais, à qui le tour ?
Fräulein Martha, le professeur d’allemand, raffolait de fessées expéditives. Elle aimait nous convoquer sur le devant de la classe et, sans même invoquer un quelconque motif, elle nous troussait et nous déculottait sans autre manière, et sitôt courbées, notre tête prise dans l’étau de ses cuisses musclées, nous n’étions pas encore revenues de la surprise que notre postérieur tout nu se retrouvait subitement revêtu d’une nouvelle culotte sur mesure qui rougissait à vue d’œil sous les claques de sa main.
Elle aurait pu se contenter de cette fessée publique, mais non ! Nous terminions en pénitence, à genoux sur le plateau de son bureau, culotte aux chevilles et robe rattachée dans le dos avec une pince, notre croupe rougie tournée vers la classe. Et surtout inutile de se plaindre ou de demander le motif du châtiment. Le pire atteignait alors des sommets. L’exemple à ne jamais suivre était venu d’une camarade.
Une seconde fessée l’avait fait taire, mais cette fois administrée sur place, alors qu’elle était déjà juchée à genoux à même le bureau. Fräulein Martha avait f o r c é la jeune fille à prendre une posture plus qu’immodeste dont elle eut longtemps à souffrir. Ses avant-bras et poignets allongés à plat sur le plateau de bois, ses reins cambrés, sa croupe juvénile nue rougie s’exhaussait honteusement, offrant à nos yeux des secrets que nous étions censées cacher.
C’est dans cette posture, la plus impudique qui soit, qu’elle reçut une nouvelle et cruelle fessée. A ma connaissance, aucune de nous ne s’avisa de reproduire l’initiative de la malheureuse.
Et précisément, dans la palette des postures de pénitence, nos préceptrices avaient le choix ! Tous les degrés de l’humiliation y étaient représentés pour isoler la coupable dans le silence inquiet de la solitude et de l’attente. Il y avait la mise au piquet simple. Vous vous teniez debout ou à genoux nez contre un mur, mains sur la tête, mais avec tous vos vêtements.
Plus embarrassant était le piquet déculotté. Vous étiez mise à genoux, ventre et derrière à l’air. En ce cas, on jetait votre jupe par-dessus la tête pour vous aveugler et votre culotte était abaissée au ras des fesses. Après une longue station dans cet apparat, il fallait vous attendre à une fessée en règle.
Il y avait une aggravation de cette pénitence, particulièrement impressionnante pour les âmes sensibles. C’était sans conteste « l’exposition » qui révoltait le plus nos jeunes pudeurs. La pénitence avait lieu dans la salle des professeurs, mais il était arrivé qu’une punie la subisse en présence de toutes les pensionnaires. Au reste, nos préceptrices ne faisaient aucun mystère pour avouer leur passion pour l’impudicité infamante de ce traitement.
« Venez ici, Mademoiselle et déshabillez-vous. Montrez à vos camarades la meilleure part de votre personne ! »
« L’exposition » consistait donc à se dévêtir entièrement devant l’assemblée des maîtresses. Puis, toute nue, se mettre à genoux et glisser les bras en extension contre le sol la tête dans les épaules, cambrer fortement les reins, et maintenir les cuisses au point que l’on éprouvait la sensation horripilante que l’entre-fesses se dilatait pour exhiber… Quelle horreur !
Et plus la croupe se dressait, plus notre orgueil s’abaissait. Nous n’étions plus que de petites choses offrant la vision de leurs chairs intégralement mises à nu.
D’autres variantes nous retrouvaient allongées à plat ventre sur la longueur d’une table, mains accrochées au rebord opposé, jambes écartées, croupe et cuisses nues en surplomb prêtes pour le fouet ou le martinet. Il y avait aussi la pose en flexion, ventre à cheval sur le dossier d’une chaise, bras étirés le long des pieds ou encore, à plat ventre sur un tabouret, bras et mains en croix sur le sol. En général, ces postures précédaient, suivaient ou accompagnaient une sévère séance de martinet.
A mes yeux, la pire de toutes était la monitrice de gymnastique et de danse. A vingt-deux ans, c’était la plus jeune de nos préceptrices. Je me suis demandé si, ancienne pensionnaire des Bouleaux, elle ne se défoulait pas sur nous des souvenirs de son séjour encore récent.
Avec elle, les séances de gymnastique qui auraient pu être des moments de pure détente prenaient parfois l’allure d’un calvaire. Toutes les occasions lui étaient propices pour nous faire subir les humiliations les plus mesquines.
Nos tenues légères composées d’un short minuscule porté à même la peau et fortement échancré à l’entrejambe et d’une courte blouse flottant sur nos jeunes seins lui facilitaient la tâche. Sans crier gare, nous pouvions être juchées sur le cheval d’arçon, les bords du short enfoncés dans la raie fessière, nos grosses joues exposées au mince jonc qui lui servait à les fouetter.
Le pire était le moment des douches. Elle avait alors à sa disposition des corps entièrement nus qu’elle faisait sautiller sur place à petits coups de jonc sur les cuisses, les mollets et les fesses.
Oh ! Le savant raffinement de ces humiliantes postures ! Là aussi, au milieu de vos cris et de vos s a n g lots, ces femmes savaient f o r c e r votre pudeur dans ses ultimes retranchements. A votre grande honte, vous affichiez au grand jour tous les aspects de votre féminité comme autant de vitrines exposant aux passants les coins les plus reculés de votre paysage intérieur.
Rien du plus profond du sillon fessier ne pouvait plus échapper à leurs regards exercés. L’on était condamnée à l’impudeur, incapable d’empêcher les fronces du petit œillet anal de s’étirer ni de défendre l’entrée du petit abricot aux lèvres gonflées.
De toutes nos préceptrices, seule Maîtresse Célia excellait dans les punitions les plus raffinées. Son flegme apparent cachait une âme ardente et un zèle impitoyable dans l’art de nous faire défaillir et nous réduire en petite fille implorante et très obéissante. Entre ses mains, le temps semblait s’arrêter. Elle s’ingéniait à s’attarder dans des préparatifs dont les atermoiements étaient bien propres à plonger nos jeunes esprits dans l’affliction.
Cela commençait par un interrogatoire, une sorte de dialogue faussement mené d’une voix douce et pleine de douloureuse gravité qui amenait peu à peu la coupable à lui livrer des aveux consentis puis à se soumettre aux plus sévères des châtiments corporels. Dès lors, Maîtresse Célia, sous des dehors pleins de scrupules, n’avaient de cesse de supputer ses choix quant à l’instrument de châtiment le mieux approprié à votre repentir, faisant partager ses feints embarras à la punie en proie aux pires incertitudes.
Face à l’effrayante panoplie des instruments de correction, elle semblait hésiter, commentant à haute voix les subtiles raisons de sa perplexité.
« Voyons, ma chérie, à votre avis quelle correction vous infliger ? … Votre faute justifie-t-elle une fouettée au martinet ou une banale fessée de ma main ? … En une année votre postérieur de jeune fille est devenu dodu à merveille. Et combien de claques pour châtier ces grosses joues ?… Et si je me contentais de cette fine cravache pour les agrémenter d’une dizaine de jolies stries ? Vous pourriez encore les admirer dans quelques jours ? …
En les voyant, vos petites camarades vous consoleraient volontiers, non ? Ou mieux encore, réchauffer vos paumes de demoiselle d’une bonne volée de cette férule de cuir… Mais non, je suis trop bonne…Je ne crois pas que ce serait suffisant. Votre carnet de discipline mentionne que vous méritez le fouet à vous arracher des cris et des larmes… une fouettée au s a n g, autrement dit ? »
Là, elle observait le désarroi et la peur qui défiguraient les traits de la pauvrette à l’énoncé de ce qui allait être une sévère fouettée.
Et le monologue pouvait se poursuivre jusqu’à ce que la jeune fille épouvantée se jette à ses genoux, les mains jointes, implorant sa clémence des larmes dans la voix.
« Et entre ces deux martinets, dois-je opter pour les six lanières plates en peau de porc qui, des reins au gras des fesses vous incendient un fessier des lueurs du couchant ? … Ou lui préférer les vives cinglées de ces douze brins de cuir qu’aucune culotte, même la plus ouatée, ne saurait vraiment am o r t ir ? …
Que penseriez-vous d’une fessée à la « cane » de jonc ? Aucune écolière anglaise ne la désavouerait ! Et la posture réglementaire en est tellement confondante pour ces jeunes misses ! Combien en ai-je vu fouettées de la sorte, buste ployé en avant et mains sur les chevilles, leur culotte baissée, leur derrière tout nu épanoui comme une fleur ! … l’angle parfait pour recevoir le « caning » ! … »
Une fessée chez Maîtresse Celia
Qui n’a connu des châtiments corporels que la façon ordinaire de les administrer ne peut pas mesurer sa chance. Les jambes et les mains libres de toute entrave, il est possible de se démener pour atténuer la douleur.
Les claques de la main, les cinglées d’un martinet ou d’une cravache ont beau mordre la chair dénudée, leurs volées se dispersent de place en place, fesses, cuisses, fesses, ménageant ainsi une alternance de douleur et de répit.
Tel n’était point le cas sous la férule de Maîtresse Célia.
Être convoquée ou envoyée chez la directrice pour un « entretien » ? L’ordre vous secouait aussi v i o l emment qu’une décharge électrique. A la seconde même, l’inquiétude vous happait et ne vous lâchait qu’au sortir de son bureau en larmes, votre petite culotte emplie d’une paire de fesses bouillantes et cramoisies à souhait… enfin, dans le meilleur des cas ! Seul le feu de l’enfer devait côtoyer le pire. J’en tremble encore sur mes jambes !
Avec elle, point de surprise. Chaque jour de la semaine et plus particulièrement les vendredis soir, comme je l’ai mentionné, nous connaissions d’avance le sort qu’elle nous réservait.
A suivre
| J'ai fait une très bonne lecture. Je mis serait cru...! | |
| Un établissement où l'on sait distribuer de bon bouleaux à tour de bras 😊 Grand plaisir à lire cette histoire, cinglante conditions de jeunes pentionnaires. Mes fesses en rougissent encore d'avoir aimé.😄 |
Ce site Internet est réservé à un public majeur et averti et est conforme à toutes les règlementations françaises en vigueur. Il contient des textes, des liens et des photos classées X qui peuvent être choquantes pour certaines sensibilités.
Je certifie sur l’honneur :
- être majeur selon la loi en vigueur dans mon pays.
- que les lois de mon état ou mon pays m'autorisent à accéder à ce site et que ce site a le droit de me transmettre de telles données.
- être informé du caractère pornographique du serveur auquel j'accède.
- je déclare n'être choqué par aucun type de sexualité et m'interdit de poursuivre la société éditrice de toute action judiciaire.
- consulter ce serveur à titre personnel sans impliquer de quelque manière que ce soit une société privée ou un organisme public.
Je m'engage sur l'honneur à :
- ne pas faire état de l'existence de ce serveur et à ne pas en diffuser le contenu à des mineurs.
- utiliser tous les moyens permettant d'empêcher l'accès de ce serveur à tout mineur.
- assumer ma responsabilité, si un mineur accède à ce serveur à cause de négligences de ma part : absence de protection de l'ordinateur personnel, absence de logiciel de censure, divulgation ou perte du mot de passe de sécurité.
- assumer ma responsabilité si une ou plusieurs de mes présentes déclarations sont inexactes.
- j’ai lu, compris et accepte sans réserve les conditions générales rédigées en français même si j’ai usage d’un traducteur automatique ou non pour accéder à ce site internet.
Toutes les images contenues dans ce site sont en accord avec la loi Française sur la pornographie (aucune image de mineur n'est présente sur ce site)